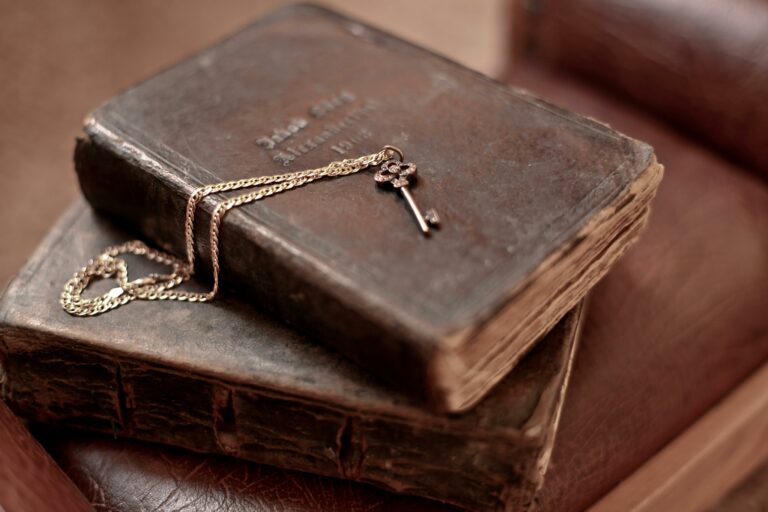Le concept de mythe familial est un élément central de la psychogénéalogie, une approche thérapeutique qui explore l’influence des héritages familiaux et des transmissions transgénérationnelles. En psychogénéalogie, ce terme fait référence aux histoires, croyances et narratives partagées au sein d’une famille, souvent de manière inconsciente, et qui influencent profondément les comportements, les valeurs et les choix des membres. Ces mythes jouent un rôle clé dans la manière dont les individus construisent leur identité, en lien avec des événements marquants, des secrets, des non-dits ou des traumatismes transmis à travers les générations.
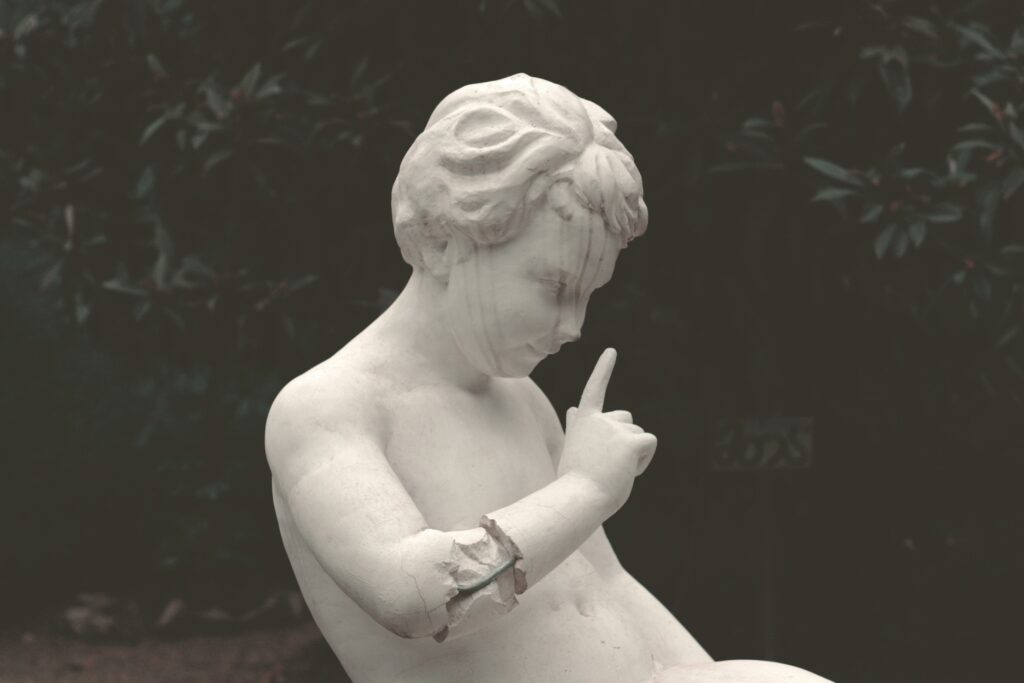
Origine du mythe familial
Le concept de mythe familial a été introduit par le thérapeute américain Antonio Ferreira dans le cadre des travaux issus de l’école de Palo Alto. Il s’inscrit dans une approche systémique de la famille, considérée comme un ensemble organisé par des règles, des croyances et des représentations partagées.
En France, ce concept a été largement développé par Robert Neuburger, psychiatre et thérapeute familial. Selon lui, le mythe familial correspond à une représentation commune que les membres d’un groupe se font d’eux-mêmes en tant que famille, ainsi que de leurs relations au monde extérieur.
Ce mythe joue un rôle fondamental de lien structurant : il contribue à définir ce qui est acceptable ou non au sein de la famille, les rôles attribués à chacun, les attentes implicites, ainsi que les croyances et valeurs qui fondent l’identité du groupe.
Contrairement à une idée répandue, le mythe familial ne se limite pas à une histoire racontée ou transmise lors des réunions familiales. Il s’agit plutôt d’un ensemble de croyances, de valeurs et de récits, parfois explicites mais souvent implicites, qui organisent la place de chaque membre dans la famille et, plus largement, dans la société. Ces représentations influencent en profondeur la manière dont la famille se perçoit, interprète les événements et entre en relation avec le monde extérieur.
Les Composants du Mythe Familial
Le mythe familial se compose généralement de plusieurs éléments qui s’articulent entre eux pour former un ensemble cohérent et structurant. Ces différents aspects participent à l’organisation de la vie familiale et influencent durablement les trajectoires individuelles.
Les Valeurs Familiales
Chaque famille est porteuse de valeurs, qu’elles soient clairement énoncées ou transmises de manière implicite. Ces valeurs orientent les comportements, façonnent les attentes et régulent les relations au sein du groupe.
Par exemple, certaines familles accordent une importance centrale au travail et à la réussite professionnelle, ce qui se traduit par une attention particulière portée aux résultats scolaires et aux performances. D’autres mettent davantage l’accent sur la solidarité et l’entraide, favorisant la cohésion, mais pouvant aussi générer des obligations implicites parfois lourdes à porter pour certains membres.
Les Croyances Familiales
Les croyances familiales se construisent au fil du temps et se transmettent souvent de génération en génération. Elles concernent des domaines essentiels tels que la réussite, l’argent, le bonheur, ou encore le rôle de chacun au sein de la famille.
Ces croyances peuvent être structurantes, en donnant un cadre sécurisant, mais aussi limitantes lorsqu’elles enferment les individus dans des scénarios préétablis. Par exemple, la croyance selon laquelle un membre serait « destiné à échouer » peut, de manière inconsciente, conduire à des comportements d’auto-sabotage et entraver son épanouissement.
Les Comportements Autorisés et Non Autorisés
Chaque famille possède un code comportemental plus ou moins explicite, parfois très rigide, qui définit ce qui est acceptable ou non.
Ainsi, dans certaines familles valorisant la force et la maîtrise de soi, l’expression émotionnelle peut être découragée, comme dans l’injonction : « un garçon ne pleure pas ». À l’inverse, d’autres environnements familiaux encouragent l’expression libre des émotions. Ces normes influencent fortement les attitudes adoptées et participent à la construction de l’identité individuelle.
Les Rôles Attribués à Chaque Individu
Dans de nombreuses familles, des rôles implicites sont assignés très tôt : le sauveur, le médiateur, le rebelle, le bouc émissaire, ou encore celui qui « ne fait pas de vagues ».
Par exemple, dans une organisation familiale patriarcale, l’homme peut être investi du rôle de pourvoyeur principal. Dans d’autres contextes où l’entraide est centrale, les enfants peuvent se voir confier la responsabilité de prendre soin des parents, parfois au détriment de leur propre trajectoire personnelle. Ces rôles influencent profondément les choix de vie, les relations et la manière dont chacun se perçoit.

Intérêts et transmission du Mythe Familial
À quoi sert le mythe familial ?
En psychogénéalogie, le mythe familial joue un rôle central. Il agit comme un liant symbolique, créant un sentiment d’appartenance, une cohésion et une identité propre à chaque famille. Ce récit partagé permet de donner du sens aux expériences communes et de distinguer la famille des autres groupes sociaux.
Lorsque ce mythe se rigidifie, se fragilise ou s’effondre, il peut toutefois devenir source de souffrance psychique. Le psychiatre Robert Neuburger montre que l’altération du mythe familial peut favoriser des difficultés transgénérationnelles : sentiment de vide, culpabilité, répétition de schémas ou troubles relationnels.
Un événement perturbateur — deuil, séparation, faillite — peut ainsi rompre l’équilibre du mythe. Certains descendants cherchent alors, souvent de manière inconsciente, à réparer l’histoire familiale, en réussissant là où un ancêtre a échoué ou en prenant en charge des besoins parentaux non satisfaits.
À l’inverse, lorsque le mythe familial reste souple et évolutif, il permet à la famille de traverser les épreuves tout en préservant une stabilité psychique d’une génération à l’autre.
Comment le mythe familial se transmet-il ?
Le mythe familial n’est pas figé. Il se transforme au fil des générations, chaque famille y intégrant sa propre lecture tout en héritant des récits du passé. Il se construit ainsi à la croisée de l’héritage transgénérationnel et de l’identité de chacun.
La transmission du mythe familial remplit plusieurs fonctions : elle renforce l’unité du groupe, assure une continuité malgré les changements, et facilite l’intégration des normes familiales tout en maintenant une singularité propre à chaque lignée.
Lorsque cet équilibre se rompt, des difficultés peuvent apparaître. Un mythe trop rigide enferme la famille et rejette les différences, tandis qu’un mythe trop conforme aux attentes sociales peut se diluer et fragiliser l’identité familiale. Le psychiatre Robert Neuburger souligne que ces déséquilibres peuvent favoriser conflits intrafamiliaux, symptômes psychosomatiques ou émergence de secrets de famille impactant les générations suivantes.
En psychogénéalogie, le travail thérapeutique vise alors à réajuster le mythe familial, afin qu’il reste vivant, souple et porteur de sens pour l’individu comme pour le groupe.
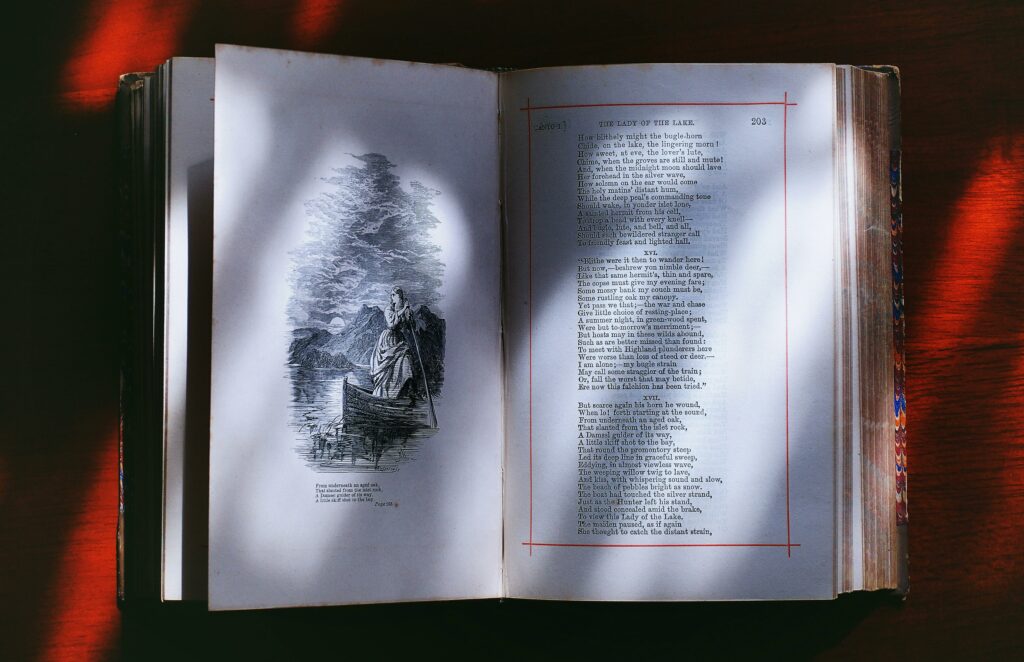
Utilisation du Mythe Familial en Psychogénéalogie
Dans son ouvrage Aïe, mes aïeux !, Anne Ancelin Schützenberger souligne que, pour comprendre un mythe familial, il est essentiel d’en appréhender le système sous-jacent : un ensemble d’éléments interconnectés et interdépendants, où chaque membre influence l’équilibre du groupe.
Dans la même perspective, Iván Boszormenyi-Nagy, figure majeure de la thérapie familiale, considère le mythe familial comme un facteur structurant du système familial. La famille fonctionne comme un système interactif, au sein duquel pensées, émotions et comportements de chacun agissent les uns sur les autres. Cette dynamique repose sur des règles implicites, souvent inconscientes, qui organisent les relations et les loyautés familiales.
La psychogénéalogie s’appuie sur cette compréhension systémique pour aider les individus à prendre conscience des récits transmis, à les interroger, et, lorsque cela est nécessaire, à s’en dégager. Cette démarche vise à redonner de la souplesse au système familial et à permettre à chacun de se réapproprier son histoire.
Révélation des croyances cachées
L’un des premiers objectifs de la psychogénéalogie consiste à mettre en lumière les mythes familiaux inconscients qui influencent la trajectoire de vie d’un individu. Cette prise de conscience permet d’identifier des schémas répétitifs, souvent à l’origine de blocages ou de souffrances psychiques.
Exploration du génosociogramme
Le génosociogramme constitue un outil central de cette démarche. Il s’agit d’une représentation graphique de l’arbre familial enrichie de données émotionnelles, relationnelles et contextuelles. Il permet de visualiser les transmissions, de repérer les répétitions, les ruptures et les événements marquants qui structurent le mythe familial.
Rupture avec le mythe
Une fois ces éléments identifiés, le travail thérapeutique vise à prendre de la distance avec les injonctions familiales limitantes. Il ne s’agit pas de renier son histoire, mais de se dégager des fidélités invisibles afin de retrouver une plus grande liberté psychique.
Création d’un nouveau récit
La psychogénéalogie propose alors la construction d’un nouveau récit personnel, plus souple et plus aligné avec les aspirations de l’individu. Ce récit intègre l’histoire familiale sans la subir, favorisant ainsi autonomie, résilience et transmission consciente.
Ainsi, l’exploration du mythe familial permet de transformer des héritages parfois contraignants en ressources, et d’ouvrir un espace de liberté intérieure propice à un positionnement plus apaisé dans sa lignée.
Comprendre le mythe familial pour s’en libérer
Explorer le mythe familial permet de mieux comprendre les héritages inconscients qui influencent nos choix et notre manière d’être au monde. En psychogénéalogie, ce travail vise à redonner de la souplesse aux récits transmis afin de se réapproprier son histoire et retrouver une plus grande liberté intérieure.
👉 Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ma page dédiée à la psychogénéalogie.
Un premier échange de 20 minutes, à distance et sans engagement, est possible si vous souhaitez en parler.