La psychogénéalogie explore la manière dont l’histoire familiale influence notre vie psychique, nos comportements et nos choix, souvent de façon invisible.
Elle repose sur l’idée que les traumatismes, non-dits, événements oubliés ou tus laissent des empreintes profondes qui se transmettent d’une génération à l’autre sous forme de répétitions, de blocages ou de schémas émotionnels récurrents.
Cette approche considère que l’individu ne peut pas être compris isolément : il s’inscrit dans un réseau de liens familiaux, d’héritages psychiques et d’événements qui continuent de résonner bien après ceux qui les ont vécus.

Origines et construction de la psychogénéalogie
Si la psychogénéalogie s’est structurée grâce aux travaux d’Anne Ancelin Schützenberger, elle s’appuie sur des courants théoriques plus anciens qui ont mis en lumière les transmissions inconscientes.
La psychanalyse
Freud a montré que l’inconscient contient des fragments de vécu refoulés, toujours actifs malgré le silence. Ses travaux ont permis de comprendre que les expériences non symbolisées continuent d’agir.
Carl Jung
Jung introduit l’idée d’inconscient collectif, composé d’archétypes et de symboles transmis au fil des générations.
Jacques Lacan
Pour Lacan, l’inconscient est structuré comme un langage. Les mots, les silences et les répétitions familiales deviennent des vecteurs de transmission.
Approches systémiques
Murray Bowen met en évidence l’importance du système familial, des dynamiques émotionnelles et des schémas relationnels hérités.
Loyautés invisibles
Ivan Böszörmenyi-Nagy met en lumière les dettes symboliques, obligations et attentes inconscientes qui traversent les générations.
Traumatismes historiques
Les recherches sur les descendants de survivants (guerres, exils, génocides) confirment la transmission traumatique entre générations.
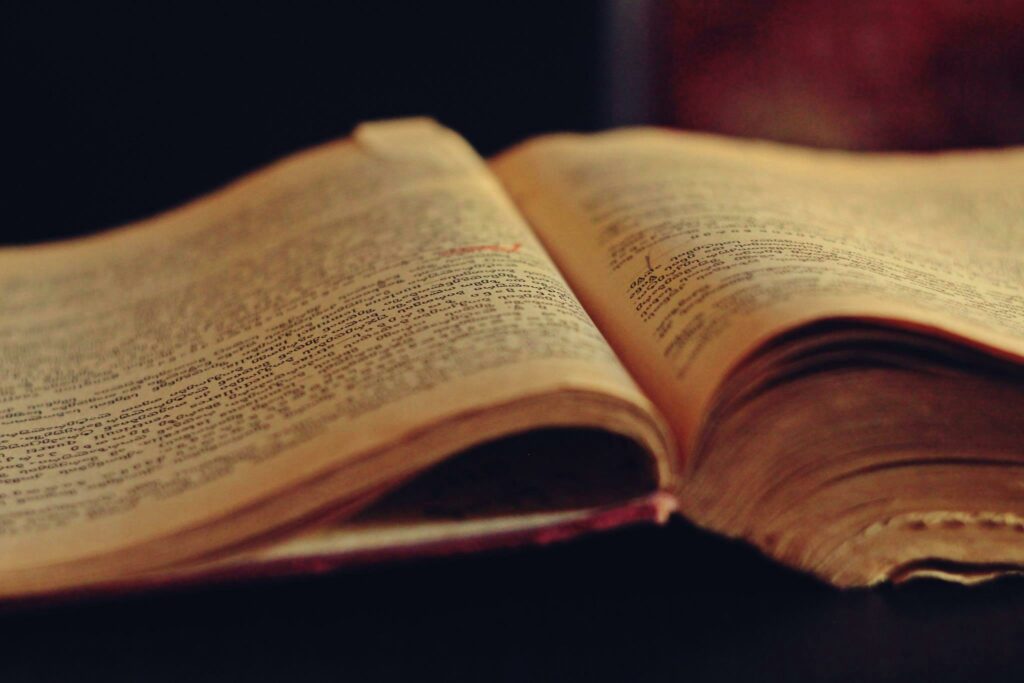
L’apport essentiel d’Anne Ancelin Schützenberger
Schützenberger a donné à la psychogénéalogie une structure, des outils et des concepts fondateurs.
Le génosociogramme
Un arbre généalogique enrichi, intégrant les événements marquants, les traumatismes, les relations et les répétitions significatives.
Il aide à repérer les zones de souffrance, les transmissions invisibles et les schémas récurrents.
Libération des blessures transgénérationnelles
Elle insiste sur la nécessité de reconnaître les traumatismes non résolus pour éviter qu’ils ne se transmettent.
La démarche peut inclure des actes symboliques, récits ou rituels permettant d’apaiser ce qui a été vécu en silence.
Répétitions familiales
Un individu peut, sans en avoir conscience, rejouer un scénario hérité : relations, choix professionnels, modes émotionnels, voire symptômes psychosomatiques.
Le travail thérapeutique aide à en comprendre l’origine et à retrouver une liberté intérieure.
Les concepts-clés de la psychogénéalogie
Voici quelques notions essentielles en psychogénéalogie, qui prennent toute leur signification lorsqu’elles sont mises en relation les unes avec les autres :
Le syndrome d’anniversaire
Répétition inconsciente d’événements douloureux ou de comportements à des dates similaires.
Souvent lié à des traumatismes non résolus.
Le mythe familial
L’histoire que la famille se raconte : valeurs, rôles attendus, identité collective.
Il peut enfermer certains membres dans un rôle figé.
Les secrets de famille
Événements ou vérités tues, honteuses ou jamais verbalisées.
Ils se transmettent par les silences, les tensions et les comportements implicites.
La crypte et le fantôme
La crypte : un traumatisme enfermé, non symbolisé.
Le fantôme : sa manifestation chez un descendant sous forme d’émotions ou de comportements qui ne lui appartiennent pas.
Transmission transgénérationnelle
Passage inconscient de schémas émotionnels, de croyances ou de stratégies de survie d’une génération à l’autre.

L’interdépendance : comprendre un système, pas des fragments
Tous ces concepts forment un réseau dynamique.
Par exemple :
- un syndrome d’anniversaire peut être lié à un secret enfoui,
- un mythe familial peut maintenir une souffrance sous silence,
- un fantôme peut révéler un traumatisme non symbolisé.
La psychogénéalogie propose de comprendre l’individu dans sa trame familiale, là où se jouent loyautés invisibles, répétitions, non-dits et héritages émotionnels.
Cette mise en lumière permet :
– de donner du sens,
– de nommer ce qui ne l’a jamais été,
– d’apaiser les mémoires familiales,
– et d’ouvrir la voie à une transformation personnelle.

se réapproprier son histoire
La psychogénéalogie met en lumière les liens invisibles qui traversent les générations et influencent nos émotions, nos choix ou nos difficultés actuelles.
Comprendre ces transmissions permet de se libérer de ce qui ne nous appartient pas et d’avancer avec davantage de clarté, d’apaisement et de liberté intérieure.
Pour aller plus loin dans cette exploration, vous pouvez découvrir :
• ma page dédiée aux schémas répétitifs et aux blocages
Et si vous souhaitez aller encore plus loin, n’hésitez pas à visiter :
• ma page sur les troubles anxieux et les TOC
• ma page consacrée à la surcharge mentale
Un premier échange de 20 minutes, à distance et sans engagement, est possible si vous souhaitez en parler.






