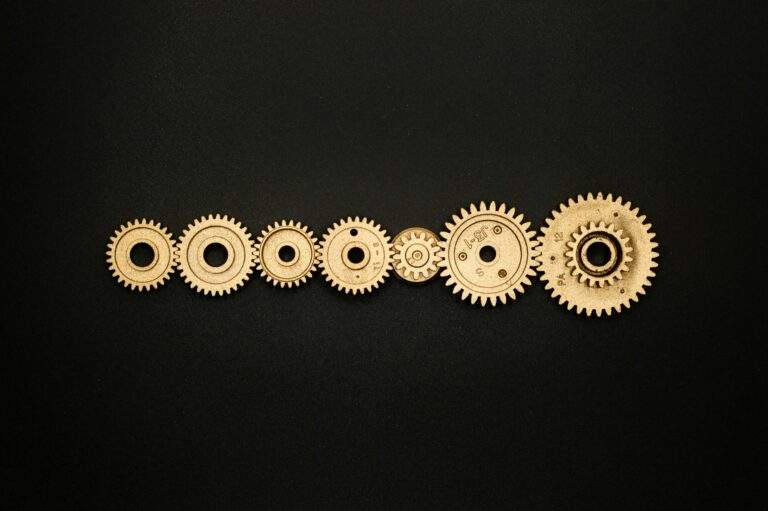En psychogénéalogie, les concepts de crypte et de fantôme trouvent leur origine dans les travaux de Nicolas Abraham et Maria Torok, deux psychanalystes d’origine hongroise, qui les ont introduit dans les années 1970 pour expliquer la transmission des traumatismes dans les familles. Ces notions permettent de comprendre comment les secrets, les blessures et les non-dits familiaux peuvent influencer, souvent inconsciemment, la vie des descendants.

La Crypte et le Fantôme : Origines psychanalytiques selon Abraham et Torok
En 1978, Nicolas Abraham et Maria Torok ont introduit le concept de la crypte et du fantôme dans leur recueil d’articles « L’Ecorce et le noyau »1.
En effet, en s’occupant de certains cas de patients, ils ont découvert que : ces patients prétendaient avoir accompli certaines tâches sans comprendre pourquoi ou même décrivaient cela différemment (intonations, accents, rythme, voix…), et que leur famille attestait qu’ils avaient agi comme si une autre personne prenait le contrôle.
« Comme s’il y avait un fantôme agissant qui parlait pour les gens à la façon d’un ventriloque et même agissait à leur place. »
Anne Ancelin schützenberger
Concept d’introspection et d’inclusion psychique
Nicolas Abraham et Maria Torok, prolongent leurs réflexions dans le lignage de Sandor Ferenczi sur le concept d’introjection et d’inclusion psychique:
- L’introjection désigne un processus par lequel un individu assimile des éléments extérieurs, c’est un mécanisme sain où l’individu « digère » à des expériences et représentations externes dans son psychisme de manière structurante.
- Par exemple, lorsqu’une perte ou un deuil est bien vécu, le sujet peut intégrer l’absence de l’être cher à son univers intérieur, ce qui lui permet de continuer à vivre pleinement sans être hanté par la douleur. L’introjection est donc un processus vital pour maintenir l’équilibre psychique.
- Au contraire, l’inclusion psychique, concept développé notamment par Abaham et Torok, représente un processus inconscient généralement dysfonctionnel. Cela se produit lorsque l’individu reçoit un contenu psychologique non assimilé d’un autre membre de la famille, généralement en relation avec un traumatisme ou un secret non développé. L’assimilation des expériences est bloquée. Ainsi, certaines émotions, idées ou images demeurent prisonnières du psychisme, incapables d’être structurées et intégrées. Ces aspects non développés, parfois associés à une expérience traumatisante, semblent se retrouver figés dans une sorte de « crypte».
Selon Abraham et Torok, l’introjection rencontre des entraves qui conduisent ainsi au processus d’inclusion psychique. Ces entraves se répartissent en deux catégories :
- Intrapsychique : se rapportent à l’intérieur du psychisme de l’individu et découlent de sa difficulté ou incapacité à gérer certaines expériences émotionnelles.
- Par exemple : Un individu face à une perte soudaine peut, sans le réaliser, décider de ne pas éprouver sa souffrance, préférant la réprimer en lui.
- Interpsychique : en relation avec les interactions et les rapports avec autrui, particulièrement dans le cadre familial ou social.
- Par exemple : Un enfant qui grandit dans une famille où un deuil majeur est négligé ne peut pas comprendre cette perte, étant donné qu’il ne reçoit ni les informations, ni l’espace émotionnel requis pour en discuter.
Lorsque l’introjection est bloquée, l’expérience traumatique ou émotionnelle reste figée et peut entraîner, la création d’une crypte psychique et l’apparition d’un fantôme.

Concept de crypte et de fantôme
La crypte
Le terme « crypte » fait référence à un espace psychique symbolique où est enfermé le traumatisme qui n’a pas été assimilé par le processus d’introjection. Dans ce mécanisme, la personne porte en elle une « chambre secrète » (la crypte) qui contient ces éléments psychiques étrangers, souvent douloureux ou inaccessibles. Ce sont des fragments de l’expérience émotionnelle ou traumatique d’un autre qui ont été enfouis et qui ne peuvent être exprimés.
Le lien entre la crypte et l’Idéal du Moi explique pourquoi certains traumatismes ou secrets sont refoulés sous forme de crypte et non simplement élaborés dans le psychisme. L’Idéal du Moi agit comme une instance morale qui rend insupportable l’idée d’associer la honte ou la faute à un objet d’amour ou d’admiration.
« Pour qu’une crypte s’édifie, il faut que le secret honteux ait été le fait d’un objet jouant le rôle d’Idéal du Moi. Il s’agit donc de garder son secret, de couvrir sa honte »Abraham et Torok
Anne Ancelin Schützenberger2, apportera une précision sur la place de la crypte dans l’appareil psychique, elle indiquera que c’est un lieu défini qui n’est ni le Moi de l’introjection ni l’inconscient dynamique, mais plutôt une « enclave entre les deux, une sorte d’inconscient artificiel, logé au sein du Moi (…) rien ne doit filtrer vers le monde extérieur. C’est au Moi que revient la fonction de gardien du cimetière » selon Abraham et Torok.3
Le fantôme
Le concept de fantôme fait écho à la crypte mais représente l’événement traumatique non résolu. Lorsque ces éléments psychiques inclus ne trouvent pas d’élaboration, ils peuvent se manifester sous la forme de ce qu’Abraham et Torok appellent un fantôme. Ce dernier est une « présence » qui hante l’individu, se manifestant à travers des comportements ou des symptômes énigmatiques. C’est une manière pour le traumatisme non résolu de réclamer reconnaissance et réparation.
Pour une meilleure compréhension reprenons la définitions donnée par les deux psychanalystes eux- même « Le fantôme est une formation de l’inconscient qui a pour particularité de n’avoir jamais été consciente […] et de résulter du passage, dont le mode reste à déterminer, de l’inconscient d’un parent à l’inconscient d’un enfant. (…) Ce ne sont pas les trépassés qui viennent hanter , mais les lacunes laissées en nous par les secrets des autres. (…) Sa manifestation, la hantise, est le retour du fantôme dans des paroles et actes bizarres, dans des symptômes. (…) Ainsi se montre et se cache […] ce qui gît comme une science morte-vivante du secret de l’autre. »4

Les nuances apportées aux concepts de crypte et fantômes en Psychanalyse
Toutefois, des nuances ont été soulignés concernant les théories d’Abraham et Torok. Ainsi Serge Tisseron5 souligne que les intuitions de Nicolas Abraham et Maria Torok ont été limitées par trois éléments :
- Ne pas avoir suffisamment intégré les observations cliniques des interactions précoces entre parents et enfants.
- Manque d’observations sur la théorie des images (matérielles ou mentales) et leur fonction de transporteurs de contenus inconscients entre les générations ; en effet, ces dernières jouent un rôle crucial comme canaux de transmission inconsciente.
- Ne pas avoir pu s’appuyer sur la théorie concernant des objets quotidiens (inexistante à ce moment-là), en-effet ces éléments de la vie de tous les jours peuvent avoir une influence sur la transmission inconsciente.
Cependant bien qu’il identifie ces limites, il reconnaît que ces manques s’expliquent en grande partie par des éléments indépendants de la volonté d’Abraham et Torok :
- Le décès prématuré de Nicolas Abraham en 1975 à l’âge de 59 ans a interrompu son travail et par conséquent certaines notions comme celles de la crypte et du fantôme sont restées partiellement esquissées et n’ont pas bénéficié d’un approfondissement théorique ou clinique ultérieur.
- Dans les années 1970, plusieurs outils théoriques ou méthodologiques n’étaient pas encore assez développés pour apporter de la clarté à leurs travaux.
- Par exemple l’observation directe des interactions précoces entre la mère et l’enfant ou la théorie des objets quotidiens qui n’existait pas à cette période.
- Durant l’ère d’Abraham et Torok, la psychanalyse était fortement marquée par Jacques Lacan, mettant un accent particulier sur le langage et la symbolisation. Cela marginalisait les aspects non-verbaux, tels que les interactions corporelles ou les objets concrets, dans l’étude des transmissions psychiques.
Abraham et Torok utilisaient les instruments à leur disposition de l’époque, donc leur théorie, bien qu’elle ne soit pas exhaustive, représentait une avancée dans la façon d’envisager les transmissions inconscientes. Ils ont établi des fondations robustes pour des recherches futures. L’idée de crypte et celle de fantôme, bien qu’elles soient seulement partiellement élaborées, ont suscité une multitude de réflexions concernant les secrets familiaux, la mémoire transgénérationnelle et les mécanismes inconscients.
Les Apports d’Anne Ancelin Schützenberger dans l’Approche Psychogénéalogique

Anne Ancelin Schützenberger, pionnière dans le domaine de la psychogénéalogie et psychothérapeute, a approfondi les notions de crypte et de fantôme en les rendant plus tangibles et accessibles grâce à sa pratique thérapeutique. Elle a particulièrement mis l’accent sur la nécessité de reconnaître et de travailler sur l’histoire familiale afin de libérer les individus du poids transgénérationnel.
Les contributions spécifiques d’Anne Ancelin à ces concepts
Anne Ancelin explore les concepts de la crypte et de la hantise transgénérationnelle sous un prisme psychogénéalogique. La crypte représente les secrets ou traumatismes enfouis dans la mémoire familiale, donnant naissance à une sorte de « crypte psychique transgénérationnelle ». Les fantômes symbolisent quant à eux les marques invisibles et non élucidées du passé familial qui tourmentent les membres de la famille, influençant leur existence et leur sens d’identité.Anne Ancelin met l’accent sur les loyautés invisibles et les répétitions familiales qui sont les expressions tangibles de ces fantômes (répétitions, coïncidences surprenantes pour des décès ou événements significatifs).
Anne Ancelin Schützenberger a également élargie la théorie d’Abraham et Torok grâce à divers apports:
- L’ouverture à la psychogénéalogie pratique : Anne Ancelin a converti les idées théoriques de la crypte et du fantôme en instruments cliniques exploitables pour examiner l’histoire familiale. Elle accompagne les personnes à déceler les secrets ou traumatismes dissimulés dans leur généalogie, en utilisant des techniques telles que le génosociogramme.
- Une approche moins théorique et plus concrète: Elle propose une approche pragmatique, centrée sur la recherche active des secrets familiaux et la mise en lumière de leur influence mais aussi tout ce qui est transmis inconsciemment, qu’il s’agisse de traumatismes, mais aussi de croyances, d’interdits ou d’attentes familiales. Elle privilégie le travail narratif et symbolique pour libérer les descendants de ces poids invisibles.
- Une Vision Plus Dynamique et Contextualisée : Schützenberger a souligné l’importance du contexte historique et social pour chaque famille. Elle a souligné que les traumatismes familiaux sont également affectés par des événements sociaux, comme les conflits armés, les transitions sociales ou économiques. De ce fait, il ne suffit pas de comprendre un traumatisme familial uniquement à travers la dynamique psychologique du refoulement, il faut également considérer l’influence des événements extérieurs.
« Dans un certain nombre de cas (…) La seule psychanalyse ou la psychothérapie individuelle, qui ne s’attache qu’au passé symbolique et à ses traumatismes dans la vie individuelle, n’est pas suffisante. Le « transgénérationnel » met l’individu en chasse de ses secrets de famille (…) dans son vrai contexte. Quand on retrouve des secrets, des révélations providentielles, un certain nombre d’affects liés au vécu difficile, de répétitions nocives et de traumatismes disparaissent. Dans l’optique transgénérationnelle, une personne souffrant d’un « fantôme qui sort de la crypte », souffre d’une « maladie généalogique familiale », d’une loyauté familiale inconsciente, des conséquences d’un non-dit devenu secret.“
« Le thérapeute, travaillant sur le transgénérationnel, aidera le client à identifier sa crypte, à libérer , en nommant le « fantôme », le porteur du fantôme qui pourra ainsi se « désidentifier », se « différencier » du « fantôme » de l’ancêtre… et permettre de partir en paix.“
Anne Ancelin Schützenberger
Les outils utilisés en psychogénéalogie
- Identifier et nommer les secrets familiaux et traumatismes:
La crypte représente un espace psychique inconscient, où des secrets ou traumatismes familiaux refoulés sont enfouis. Ces contenus sont inaccessibles à la conscience mais influencent la psyché des descendants et la psychogénéalogie aide à mettre en lumière ces non-dits, souvent transmis de manière silencieuse par des comportements, des tabous ou des lacunes dans les récits familiaux. - Rompre avec les répétitions transgénérationnelles (« libérer le fantôme »):
Le fantôme est une formation inconsciente résultant de ces secrets ou traumatismes, qui « hante » les descendants en se manifestant par des symptômes (phobies, troubles), des comportements inexplicables ou des répétitions de destin.
En identifiant les loyautés invisibles et les schémas récurrents, la psychogénéalogie permet de comprendre pourquoi certains événements semblent se répéter d’une génération à l’autre - Favoriser l’individuation et l’autonomie psychique:
L’étude de l’histoire familiale grâce à des outils comme le génosociogramme aide à clarifier les influences inconscientes héritées des générations passées.
En reconnaissant et en intégrant ces influences, la psychogénéalogie permet de reprendre son pouvoir personnel et de se dégager des poids ou des attentes inconscientes. - Réparer les liens familiaux:
Les cryptes et les fantômes génèrent souvent des dynamiques conflictuelles ou dysfonctionnelles dans les relations familiales, nourries par des non-dits, des rancunes ou des malentendus. La psychogénéalogie invite à explorer ces tensions en réintégrant les récits manquants, en travaillant sur la transmission des blessures et en rétablissant une forme de continuité narrative. - Transmission consciente aux générations futures:
En travaillant sur les cryptes et les fantômes, la psychogénéalogie permet non seulement de se libérer soi-même, mais aussi de mettre fin à la transmission inconsciente de ces fardeaux.
La psychogénéalogie aide à mettre des mots sur l’indicible, symbolisant ce qui était enfoui pour initier une libération. Elle permet de rompre avec les répétitions transgénérationnelles, différenciant ses propres désirs de ceux hérités de l’inconscient familial. En retrouvant une plus grande liberté de choix et en restaurant des liens familiaux harmonieux, elle allège les générations futures des charges émotionnelles inutiles et favorise une transmission saine.
Conclusion : L’Apport du Concept de Crypte et de Fantômes en Psychogénéalogie
Une compréhension des transmissions inconscientes
Les concepts de crypte et de fantômes, développés par Abraham et Torok, enrichissent la psychogénéalogie en mettant en lumière, grâce au travail d’Anne Ancelin Schützenberger la manière dont les secrets familiaux refoulés et les traumatismes non élaborés se transmettent inconsciemment à travers les générations. Ces idées permettent d’expliquer les symptômes ou comportements inexplicables chez les descendants, en les reliant à des lacunes ou des non-dits dans l’histoire familiale.
Un outil de libération et de transformation
En identifiant et en symbolisant ces cryptes et fantômes, la psychogénéalogie offre un chemin pour rompre avec les répétitions transgénérationnelles et retrouver une autonomie psychique. Cette démarche permet non seulement une libération individuelle, mais aussi une transmission plus consciente et apaisée aux générations futures, favorisant ainsi un meilleur équilibre familial.

Identifier les Cryptes et les Fantômes pour s’en défaire
La psychogénéalogie permet de mettre en lumière les secrets familiaux et les non-dits enfouis (cryptes), en leur donnant une place consciente dans l’histoire personnelle et collective. Elle aide à rompre les schémas répétitifs et les loyautés invisibles liés aux « fantômes », ces transmissions inconscientes qui influencent les descendants. En intégrant ces éléments, elle offre une libération émotionnelle et une autonomie psychique, permettant de vivre plus librement et en accord avec ses propres désirs.
Si vous souhaitez en savoir plus ou commencer un travail en psychogénéalogie, n’hésitez pas à me contacter.
- « L’écorce et le noyau » 1978 – Éditions Flammarion . ↩︎
- Anne Ancelin Schützenberger « Aieu, mes aieux! » ↩︎
- « L’écorce et le noyau. 1978″- Éditions Flammarion. ↩︎
- Abraham, N. & Torok, M. (1978) « L’écorce et le noyau » Éditions Flammarion – Source Anne Ancelin Schützenberger « Aieu, mes aieux! » ↩︎
- Serge Tisseron : « Maria Torok, les fantômes de l’inconscient » ↩︎