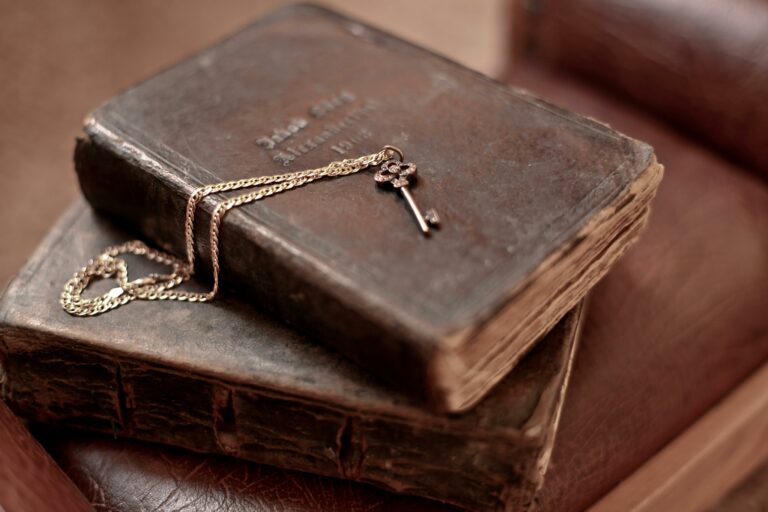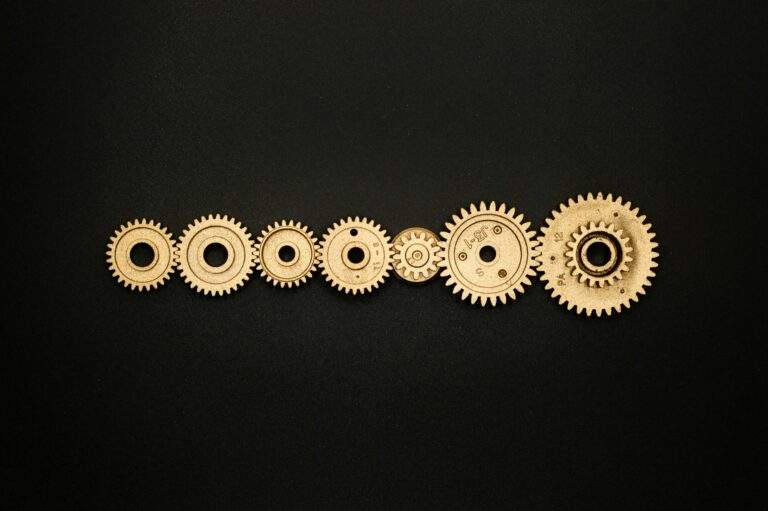Le lien entre les pensées automatiques, les distorsions cognitives, et les schémas cognitifs est fondamental en thérapie cognitive comportementale (TCC), car ces trois concepts interagissent pour influencer notre manière de percevoir, d’interpréter et de réagir aux événements de la vie. Voici un aperçu de la façon dont ces trois éléments se connectent et se renforcent mutuellement.

Schémas cognitifs
Les schémas cognitifs sont des structures mentales profondes et durables, souvent façonnées dès l’enfance, qui reposent sur des croyances fondamentales et intermédiaires. Ils représentent des convictions profondément ancrées sur soi-même, les autres et le monde en général. Ces schémas peuvent être positifs ou négatifs et influencent notre manière de percevoir et d’interpréter les événements de la vie.
Dans les théories cognitives, notamment celles d’Aaron Beck, cette idée a permis de mieux comprendre comment les schémas cognitifs impactent nos pensées, émotions et comportements. Ces schémas agissent comme des filtres qui interprètent les informations en fonction de croyances préexistantes. À travers les distorsions cognitives — des erreurs systématiques dans le traitement de l’information — ces schémas modifient notre perception du monde, créant des événements cognitifs (pensées automatiques) qui, à leur tour, déclenchent et maintiennent certains comportements.
Ces croyances peuvent être positives ou négatives et influencent la manière dont une personne pense, ressent et agit.
Les schémas cognitifs influencent à la fois nos émotions, nos cognitions et nos comportements. Jeffrey E. Young a identifié 18 schémas (primaires et secondaires) en voici quelque uns:
- Schéma d’abandon/instabilité : Il s’agit de la peur intense de perdre les personnes importantes dans notre vie. Cette peur peut inclure la crainte d’être abandonné, remplacé, ou de les voir disparaître, ce qui crée un sentiment d’isolement affectif.
- Schéma de méfiance/abus : Ce schéma consiste à anticiper constamment des situations d’abus, d’injustice, de manipulation, de trahison ou d’humiliation. Il génère l’impression que les autres tenteront de profiter de nous si l’occasion se présente, entraînant une hypervigilance et une méfiance constante.
- Schéma de carence affective : Ce schéma renvoie à la sensation que ses besoins fondamentaux d’affection ne sont jamais pleinement satisfaits par les autres. L’individu peut éprouver le sentiment que certains de ces besoins ont été ignorés par le passé, ce qui nourrit la crainte qu’ils seront de nouveau négligés à l’avenir.
- Schéma d’imperfection/honte : Ce schéma est marqué par un sentiment d’infériorité ou de défectuosité, et une insécurité concernant la valeur personnelle, amenant des doutes comme « Suis-je assez ? ». C’est l’impression de ne pas mériter l’amour ou l’affection des autres.
- Schémas d’échec : Les personnes ayant ce schéma sont particulièrement sensibles à toute expérience d’échec, qu’elle soit réelle ou anticipée. Le doute de soi est souvent au premier plan. Elles ont le sentiment d’être inférieures en termes de compétences ou de réussites et se comparent constamment aux autres, se percevant comme moins intelligentes, moins talentueuses ou moins habiles. Elles ont tendance à anticiper l’échec et cela peut les amener à s’auto-saboter ou d’autres personnes réagissent à ce schéma en redoublant d’efforts mais vivront avec un certain syndrome de l’imposteur.

Distorsions cognitives
Ce sont des erreurs de pensée systématiques qui surviennent souvent en réponse à des situations stressantes ou menaçantes. Ils agissent comme des filtres, la personne ne va valider que ce qui va dans le sens du filtre. Les distorsions cognitives sont des manifestations des schémas cognitifs négatifs et influencent la manière dont une personne perçoit une situation.
Il existe plusieurs types de distorsions cognitives, qui sont des biais de pensée pouvant influencer négativement nos émotions et nos comportements :
- La pensée dichotomique (tout ou rien) : Il n’y a aucune nuance dans la perception des situations. Tout est perçu en termes extrêmes. Exemples : « Si je n’ai pas été embauché, c’est que je ne vaux rien. » ou « Si je n’ai pas 20/20 à cet examen, alors je suis nul. »
- La surgénéralisation :Cela consiste à partir d’un événement particulier pour en déduire une règle générale. En général, on élabore des règles pour l’avenir à partir de certains éléments négatifs du passé. Exemple : « Elle a refusé de sortir avec moi, je n’arriverai jamais à être en couple. »
- L’abstraction sélective (filtre mental négatif) : On ne retient que les aspects négatifs d’une situation, en ignorant les éléments positifs. Exemple : « J’ai passé une bonne soirée avec des amis, mais comme quelqu’un m’a renversé de la bière dessus, la soirée était totalement gâchée. »
- La disqualification du positif : On transforme une expérience positive ou neutre en quelque chose de négatif. Exemple : « On me fait un compliment, mais c’est juste pour me faire plaisir, pas parce que c’est vrai. »
- L’inférence arbitraire (conclusions hâtives) : On tire des conclusions négatives sans preuve. Exemple : « Mon patron m’a regardé de travers ce matin, il veut sûrement me virer. »
- La maximisation et la minimisation : On exagère ses défauts et minimise ses qualités. Exemple : « J’ai fait une erreur au travail, tout le monde va le savoir et je vais être ridicule. » ou « J’ai trouvé la solution au problème, mais c’était juste un coup de chance. »
- Le raisonnement émotionnel : On considère ses émotions comme une preuve de la réalité. Exemple : « Je me sens incapable d’affronter cette situation, donc je suis un raté. »
- Les fausses obligations : On se fixe des exigences rigides pour soi ou pour les autres. Exemple : « Je dois toujours réussir, sinon je suis un échec. » ou « Après tout ce que j’ai fait pour lui, il me doit au moins de la reconnaissance. » Cela entraîne frustration et ressentiment.
- L’étiquetage : On applique des jugements définitifs et excessifs à soi-même ou aux autres. Exemple : « Je suis complètement nul. » ou « Cette personne est un monstre. »
- La personnalisation : On relie des évènements particuliers à soit même. Exemple : « Si mon ami est de mauvaise humeur, c’est sûrement à cause de moi. »
Identifier ces distorsions permet de mieux comprendre nos réactions et de les corriger pour adopter une perception plus équilibrée et réaliste.
« Les erreurs systématiques maintiennent chez les personnes leurs croyances de base en dépit de la présence d’éléments concrets contradictoires«
A.T. Beck
Les pensées automatiques

Les pensées automatiques sont des réactions instantanées et spontanées face aux situations du quotidien. Bien qu’elles puissent parfois être réalistes, elles sont souvent influencées par des schémas cognitifs sous-jacents et altérées par des distorsions cognitives.
Ces pensées surgissent rapidement et de manière involontaire, avant même l’apparition des émotions. Elles ne sont pas toujours rationnelles ni fondées sur des faits, mais elles exercent une influence significative sur notre état émotionnel. Lorsqu’elles induisent des émotions négatives comme l’anxiété, la tristesse ou la colère, elles renforcent le cycle des schémas et des distorsions cognitives. C’est pourquoi leur identification joue un rôle clé dans l’analyse fonctionnelle et constitue un élément central du travail cognitif en thérapie.
Exemple de pensées automatiques:
- Prise de parole en public
- Pensée automatique : « Je vais faire une erreur et tout le monde va me juger. »
- Rejet d’une idée ou d’une proposition au travail
- Pensée automatique : « Si mon idée a été rejetée, cela veut dire que je suis incompétent(e) et que personne ne me respecte. »
L’interdépendance de ces notions
Les schémas cognitifs sont des croyances ancrées en nous sur lesquelles vont agir les distorsions cognitives, en agissant comme des filtres à travers lesquels nous interprétons la réalité.
Les distorsions cognitives influencent directement les pensées automatiques, qui sont des réponses immédiates et souvent biaisées aux situations vécues.
Ces pensées automatiques, si elles sont persistantes et dysfonctionnelles, peuvent maintenir et renforcer les schémas cognitifs négatifs, créant ainsi un cycle de pensée négative qui peut affecter les émotions et comportements.
Modèle cognitif du traitement de l’information 1

Prenons un exemple concret d’un individu ayant:
- Schéma cognitif d’abandon: « Les personnes m’abandonnent toujours » (ou « Les relations sont instables. »):
- Ce schéma est souvent formé chez des personnes ayant vécu des expériences de rejet ou d’abandon, que ce soit dans l’enfance (par exemple, une séparation parentale, des ruptures amicales ou amoureuses répétées) ou dans des relations marquées par une instabilité émotionnelle.
- Distorsion cognitive : Surgénéralisation
- Rappelons que c’est une distorsion où la personne tire des conclusions très larges à partir d’un événement isolé. Ainsi une seule expérience négative peut être interprétée comme une règle générale valable pour toutes les situations futures, ce qui peut conduire à des pensées excessivement pessimistes.
- Pensée dysfonctionnelle résultante :
- Imaginons que cette personne traverse une rupture amoureuse, ou même une dispute avec un ami proche. Son schéma d’abandon, couplé à la distorsion de surgénéralisation, pourrait la faire penser ceci :
- « C’est fini, je vais toujours être abandonné(e).
- Chaque fois que je me lie à quelqu’un, ça finit mal.
- Les gens finissent toujours par me quitter, personne ne restera jamais dans ma vie. »
- Imaginons que cette personne traverse une rupture amoureuse, ou même une dispute avec un ami proche. Son schéma d’abandon, couplé à la distorsion de surgénéralisation, pourrait la faire penser ceci :
Comment cela fonctionne :
- Schéma cognitif d’abandon/instabilité: fait croire à la personne que les relations humaines sont par nature fragiles et qu’elle sera inévitablement rejetée ou abandonnée. Ce schéma est basé sur une vision profondément ancrée de l’instabilité dans les relations.
- Distorsion cognitive de surgénéralisation : En lien avec ce schéma, la personne est susceptible de généraliser une expérience (comme une rupture ou une dispute) à toutes les relations futures.
- Pensée dysfonctionnelle : La personne arrive à la conclusion que les relations sont systématiquement instables, et qu’elle est condamnée à être seule ou abandonnée. Cela renforce une vision pessimiste de l’avenir et la croyance que la solitude ou l’abandon sont inévitables.
- Impact sur la personne:
- Cette pensée dysfonctionnelle peut mener à plusieurs comportements :
- Évitement : Par peur de l’abandon, la personne pourrait éviter de s’engager dans de nouvelles relations ou de se rapprocher des autres, par peur que cela mène encore à une séparation.
- Attachement excessif ou dépendance émotionnelle : Au contraire, certains peuvent chercher à se « raccrocher » de manière excessive à une relation, par crainte qu’une autre séparation ne se produise.
- Répétition de cycles relationnels toxiques : La croyance en l’abandon constant pourrait également amener une personne à choisir inconsciemment des partenaires ou des amitiés instables, où l’abandon ou la rupture deviennent des prophéties auto-réalisatrices.
- Cette pensée dysfonctionnelle peut mener à plusieurs comportements :
Le lien entre pensées automatiques, distorsions cognitives, et schémas cognitifs est évident . Les schémas cognitifs sont des filtres, interprétant les informations selon nos croyances. Les distorsions cognitives vont influencer ces schémas, générant des pensées automatiques qui, à leur tour, déclenchent et maintiennent certains comportements

Le Rôle de la TCC dans la Modification des Schémas, Distorsions Cognitives et Pensées Automatiques
La thérapie cognitive comportementale (TCC) travaille à identifier et à modifier ces schémas,distorsions et pensées dysfonctionnels en aidant les individus à les reconnaître, les remettre en question et les modifier pour des croyances plus adaptatives et réalistes.
N’hésitez plus et retrouver votre santé mentale grâce aux TCC, si vous souhaitez en savoir plus ou commencer un travail n’hésitez pas à me contacter.
- Source : site internet « Apprendre les TCC » – Matthieu FERRY ↩︎